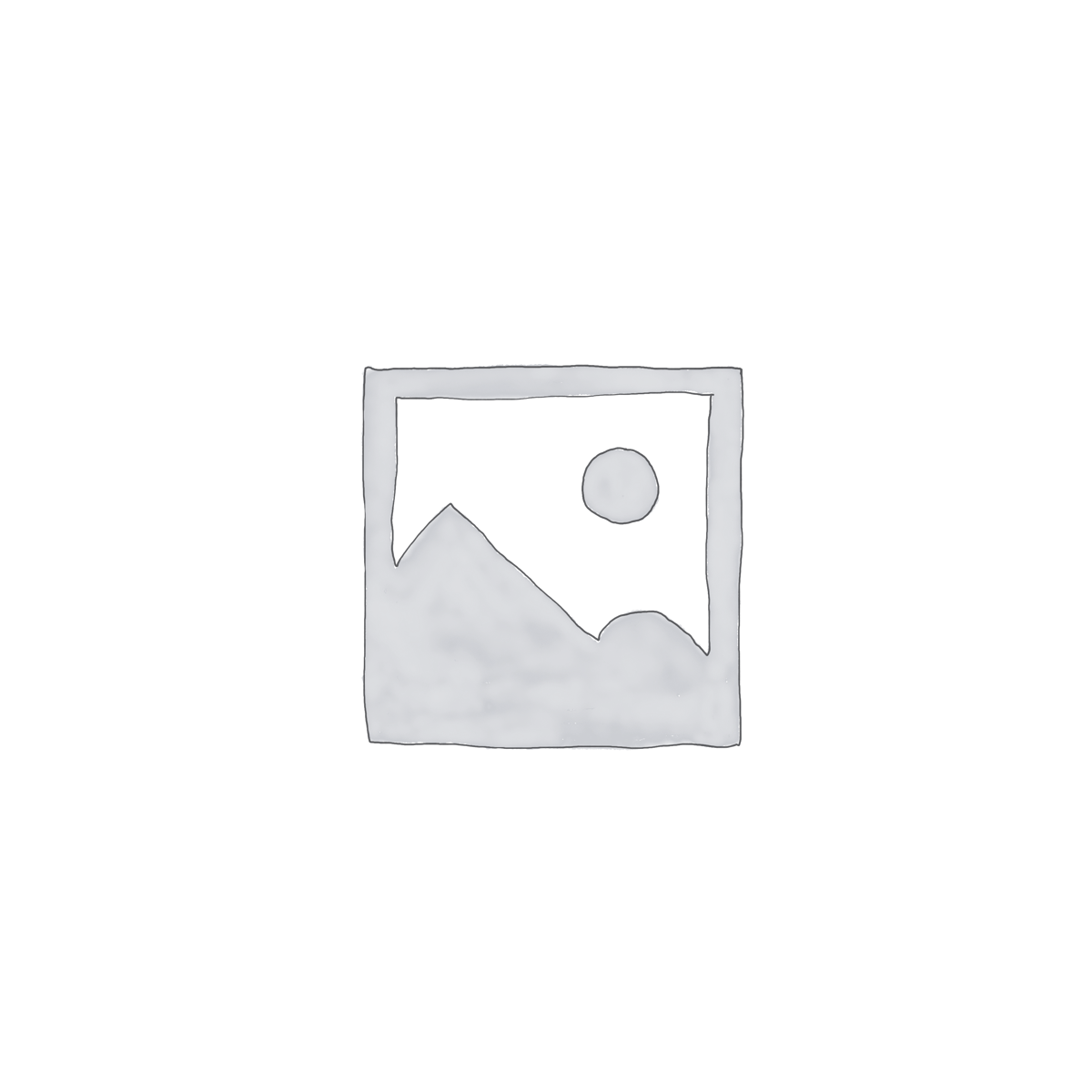Le transport du combustible nucléaire et des déchets radioactifs fait régulièrement la Une de la presse, pour les débats relatifs aux choix énergétiques de société qu’il suscite. Un des derniers transports en date ayant utilisé le maillon ferroviaire est le retour en Suisse de déchets métalliques compactés issus du recyclage de combustibles usés en provenance de la centrale nucléaire suisse de Beznau (au sud-ouest de Döttingen, une ville située à proximité de la frontière germano-suisse). Fret SNCF, filiale de SNCF Geodis, a pris en charge le convoi de trois emballages (chaque type de marchandises possède un conditionnement conçu « sur mesure », plus ou moins complexe selon les caractéristiques du contenu, tel l’emballage dénommé « castor ») à Valognes, sur le terminal spécialisé rail-route exploité par TN International. Cette dernière entité est la filiale européenne de la business unit BU Logistique d’Areva, en charge des emballages spécifiques et du transport en France et à l’international. En suisse, les CFF ont pris le relais afin d’acheminer le convoi jusqu’au site d’entreposage Zwischenlager Würenlingen SA (Zwilag), un peu plus au sud de la centrale nucléaire citée précédemment. Les deux sites sont à proximité de la voie unique électrifiée Turgi – Koblenz, au nord de l’axe Bâle – Zurich. À propos du ferroviaire, EDF explique que « dès lors qu’il existe une liaison ferroviaire disponible, ce mode de transport est choisi en priorité pour les colis lourds ou encombrants. Par exemple, la quasi-totalité du combustible usé destiné au retraitement est transporté par chemin de fer jusqu’au terminal ferroviaire de Valognes (Manche), puis par route jusqu’à l’usine Areva de la Hague ». Construit en1982, Valognes est « le plus grand terminal au monde pour les transferts rail-route » dédié à ce type de marchandises, comme le qualifie Areva. Il y a quelques années, le groupe français du nucléaire mentionnait le chiffre de 1 000 transferts par an. Situé dans la zone d’activité d’Armanville, le complexe est embranché sur la double voie électrifiée de Cherbourg, à la sortie nord de la gare de Valognes. Il comprend un premier faisceau de trois voies, dont deux sous portiques de manutention, et un second faisceau de quatre voies de stockage des wagons. Les entrées et sorties ne peuvent se faire que de et vers Valognes. Cette plate-forme constitue la base logistique du site Areva de La Hague (25 km à l’ouest de Cherbourg), qui assure « la première étape du recyclage des combustibles usés provenant des réacteurs nucléaires ». La quarantaine de kilomètres qui séparent La Hague de Valognes est couverte au moyen d’ensembles routiers d’une capacité maximale de 160 t. Ce transport est réalisé par LMC (Lemaréchal-Célestin), filiale de TN International.
« En fonction du niveau de sécurité et de confidentialité devant être appliqué à leurs transports, les matières radioactives ont été classifiées en trois catégories, directement liées à leur teneur en produits fissiles (principalement uranium 235 et plutonium 239) », précise Areva. Ainsi, la catégorie I, celle re- quérant « le plus haut degré de sécurité et de confidentialité », correspond au transport de plutonium, d’uranium hautement enrichi et des combustibles MOX. On trouve ensuite les catégories II et II irradié ainsi que la catégorie III. En termes de sûreté et de sécurité, ces convois sont très suivis et font intervenir un grand nombre d’acteurs, parmi lesquels l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), le Centre opérationnel de gestion interministérielle de crises (Cogic), le Centre ministériel de veille opérationnelle et d’alerte (CMVOA), le Centre opérationnel de suivi (COS) de TN International et, bien sûr, l’ensemble des services des forces de l’ordre.TN International précise qu’il « réalise les transports de matières radioactives conformément aux réglementations internationales édictées par l’Agence internationale à l’énergie atomique (AIEA) et aux réglementations nationales en vigueur ». En outre, « la réglementation relative au transport des combustibles usés et des déchets radioactifs […] impose de ne pas communiquer les itinéraires pour des raisons de sécurité ». À noter que, pour le rail, compte tenu de la géographie ferroviaire française, la confidentialité sur les itinéraires est toute relative. En effet, si on associe le caractère clairsemé de la desserte du Cotentin à la volonté d’éviter la région parisienne et au manque d’« itinéraires bis » du réseau ferré national, les alternatives offertes aux exploitants sont peu nombreuses. En France, TN International utilise d’autres plates-formes, comme celle de la gare d’Orsan (deux voies en impasse avec un portique de manutention), qui dessert le complexe de Marcoule, ou celle du port de Cherbourg (deux voies sur le quai des Flamands) pour les échanges par mer. D’autres sites ferroviaires d’échange à proximité des différentes centrales nucléaires sont également utilisés en fonction des besoins.