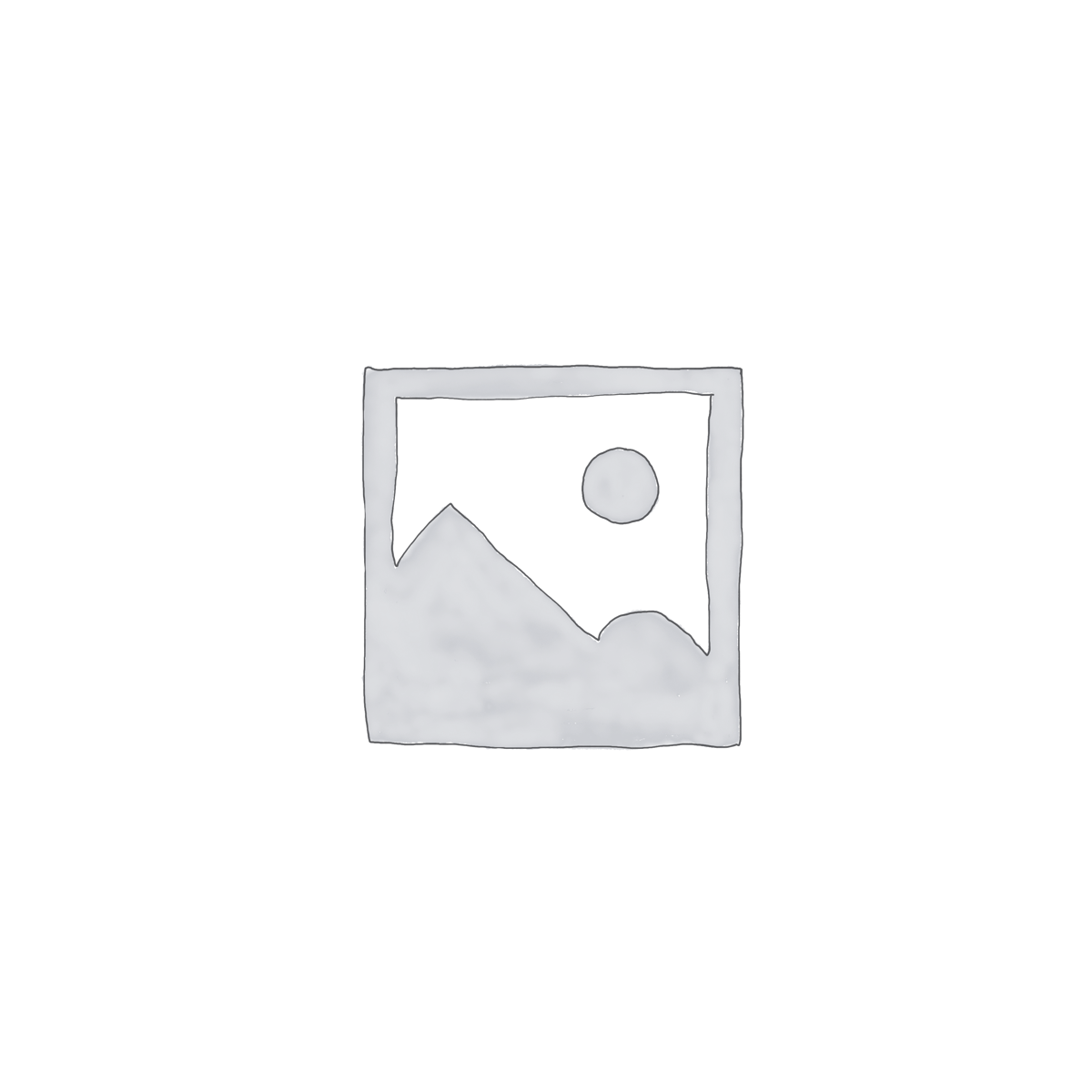Avec la collaboration de Bruno Carrière, Bruno Leroux, Marie-Noëlle Polino et Julie Balcar, Cécile Hochard signe un fort volume d’illustrations, Les Cheminots dans la Résistance. L’ouvrage reprend des documents sélectionnés pour l’exposition commandée en 2005 par la Fondation de la Résistance ; exposition présentée en premier lieu au Musée du général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris-Musée Jean Moulin, avant de circuler ensuite en province. Des documents peu connus, dispersés dans divers centres d’archives, musées, bibliothèques et collections privées, avaient été alors rassemblés pour illustrer l’état actuel des connaissances concernant la participation des cheminots à la résistance contre l’occupant allemand entre 1940 et 1944. « Le choix n’a pas été facile », rappellent les auteurs dans l’avant-propos, prenant le parti de privilégier « outre la nouveauté, le caractère exemplaire des actions et les itinéraires des personnes, souvent complexes, toujours uniques. » De nombreux documents peu connus et photos retiennent l’attention eneffet, comme l’évocation de nouveaux thèmes jusqu’alors délaissés. Telle, objet de débats si ce n’est de polémiques, l’évocation des rafles et des transfèrements des juifs de la zone sud sur Drancy, depuis Marseille (p. 91) ou Nexon (p. 19), qui mettent en œuvre les « wagons à bestiaux » de la SNCF : un sujet qui n’est plus tabou. L’ouvrage se risque à évoquer un dénombrement officiel des cheminots victimes : « 1 106 morts en déportation ou disparus, 502 fusillés et 39 décédés de causes diverses après leur arrestation » (p. 28). Des décomptes qui ont toujours varié selon les époques et les documents, sans doute à jamais incertains !
Incontournables, « les deux figures emblématiques de la résistance cheminote », les figures tutélaires du militant syndicaliste martyr Pierre Sémard 2 et de l’ingénieur héros Louis Armand, sont souvent évoquées, voire rapprochées (p. 15) ; équilibre « politique » préservé avec l’évocation de cheminots héros de second plan : d’un côté, l’ex-député communiste Jean Catelas, exécuté le 24 septembre 1941 ou l’ajusteur aux Ateliers de Bischheim Georges Wodli, qui mourra au camp du Struthof en avril 1943 (p. 118) ; de l’autre, le technicien René Pottier qui, sous couvert de suivi du TIA 3 d’un dépôt à l’autre, a tissé un réseau d’informateurs au service d’Armand, avant d’être arrêté et déporté en Allemagne où il mourra en février 1945 (p. 64) ; ou encore le mécanicien de Brive, Léon Bronchart, enfin exhumé de l’oubli (p. 87), qui se distinguera par son refus de tirer un train de détenus politiques transférés d’une prison à une autre, et survivra à sa déportation.

L’ouvrage rappelle pertinemment les deux visions historiquement et politiquement opposées de la résistance cheminote (p. 190). La première était en quelque sorte la « version officielle » que développe l’ouvrage commandé au cadre supérieur Paul Durand, par Louis Armand (« le plus illustre des cheminots résistants », dixit le président de la SNCF André Ségalat). Résultat d’un long travail de documentation et de compilation de sources variées, cet ouvrage : La SNCF pendant la guerre. Sa résistance à l’occupant, paraît en 1968 aux Presses universitaires de France ; il répond aux instructions d’Armand qui avait chargé l’auteur de relater « la résistance de la SNCF en tant que personne morale » : c’est-à-dire la mise en avant de « l’épopée des résistants actifs du rail » mais rappelant « le consensus quasi unanime de toute la corporation, forte alors de 400 000 agents » ; corporation « où ces actifs trouvèrent, en maintes occasions dramatiques, la même protection que s’ils avaient été sous le couvert d’un immense maquis ! » Image certes judicieuse que ce « maquis » offert par la SNCF, mais qui n’était pas néanmoins à l’abri de dénonciations internes 4 !
La seconde vision constitue le tableau publié deux ans plus tard par le journaliste et historien communiste Maurice Choury, rassemblant dans son livre Les Cheminots dans la bataille du rail (Librairie académique Perrin, 1970) de multiples témoignages directs de survivants. La thèse mise en avant souligne l’engagement pionnier des cheminots ex-syndiqués unitaires ou communistes, dans le cadre de l’Organisation spéciale (OS), le bras armé du Parti communiste clandestin.
L’auteur prenait position contre la thèse du consensus moral corporatif (p. 151) : « C’est en vain que Paul Durand, dans son ouvrage La SNCF pendant la guerre, tentera d’accréditer la thèse de la résistance de la SNCF en tant que « personne morale ». Si le personnel a payé cher sa participation à une bataille du rail qui n’a pas commencé en juin 1944 mais en juin 1940, si nombre d’ingénieurs et cadres des chemins de fer se sont associés à la Résistance, les documents que nous avons reproduits ne laissent aucun doute sur la « collaboration » de nombreux hauts dirigeants de la SNCF de l’époque. » À ce titre, il est très contestable d’affirmer que « tous les acteurs » de cette mémoire corporative « se retrouveront pour œuvrer à la réalisation du film La Bataille du Rail » (p. 188) ; les débats ici déjà évoqués dans le cadre de l’émission des Dossiers de l’écran en témoignent 5 ; le film profitera surtout à l’association créée par Louis Armand et confortera son discours mobilisateur d’une nouvelle « bataille du rail » à mener, celle de l’urgente et impérative reconstruction du rail français, comme le rappelle sans ambiguïtés cette affichette de la SNCF diffusée en 1946,reproduite p. 198 : « Pour nous, cheminots, La bataille du rail continue. » Cette sourde mais profonde ligne de fracture est bien évoquée, et notamment son origine, la traque anti-communiste au sein de la SNCF, centralisée et atténuée jusqu’en juin 1941, avant de s’appuyer sur des enquêtes décentralisées au sein de ses établissements, où l’inspecteur de police local pourra compter directement « sur le concours de cadres ou d’agents délateurs » incités à collaborer ainsi (p. 167-168) ; l’été 1941 voit la mise en place au sein de la SNCF des directives Berthelot : elles visent « la destruction du communisme » avec appel à « tous les échelons du commandement », du directeur de région jusqu’aux chefs d’équipes (p. 176-177).
Si l’épuration au sein de la SNCF est encore un sujet tabou, c’est de ces plaies vives à la Libération qu’elle se nourrira essentiellement à l’encontre de directeurs et ingénieurs qu’accuseront les initiatives anti-communistes qu’ils ont assumées dans cette traque qu’elles relèvent d’une authentique conviction personnelle ou de la simple volonté de manifester leur zèle professionnel. Été 1941 : l’impact des premiers sabotages ferroviaires Le 22 juin, la rupture du pacte germano-soviétique et l’entrée en guerre des Allemands contre l’URSS déclenchent les inquiétudes bien fondées du chef du gouvernement, l’amiral Darlan, tandis que le 12 août, Pétain sent « se lever depuis quelques jours un vent mauvais ». Le secrétaire d’État aux Communications, Jean Berthelot, ancien directeur général adjoint de la SNCF, est très vite sommé de réagir… (cf. encadré ci-dessous) Ces directives en effet sont répercutées au sein de la hiérarchie de la SNCF le 7 juillet par le président Fournier, puis le 10 juillet par le directeur général Le Besnerais. Les chefs d’établissement qui découvrent des tracts ou des affiches communistes, sont invités « à en rechercher les auteurs et à leur infliger des sanctions rigoureuses », tout comme ils doivent signaler aux préfets les agents suspectés de se livrer à une telle propagande. Dans ses mémoires 6, l’ancien métallo Roger Linet qui a rejoint le parti communiste clandestin après son évasion de la citadelle de Laon, membre dès juin 1941 de l’Organisation spéciale en région parisienne, évoque la manière dont fut conçu le premier sabotage ferroviaire important. Un cheminot communiste employé sur la Grande Ceinture et qui dispose d’un observatoire privilégié, son jardin proche de la voie ferrée, près d’Épinay-sur-Seine, l’informe du passage, au moins deux fois par semaine, de convois de matériels de guerre sortis tout neufs d’usine. Ainsi Linet apprend qu’un tel convoi passera le 17 juillet, vers 22 h 45, comme toujours précédé 8 à 10 minutes avant d’une machine haut le pied, pour s’assurer de la voie libre. D’où la préparation d’un grand coup : « 22 h 45, c’est bien après l’heure du couvre-feu… Pour réussir un déraillement, il faut du matériel (et du temps) et il faut dévisser les deux rails parallèles. Or, les clés à tire-fond et les clés à éclisses sont lourdes, longues, encombrantes, donc le mieux est d’en faire fabriquer qui soient démontables. Ce qui fut fait par un artisan sympathisant. Il faut que ce soit solide, car les lignes de chemin de fer ne sont pas spécialement des joujoux.
Une reconnaissance des lieux, dans la journée, loin des regards indiscrets, permet de choisir l’endroit, sitôt après une courbe là où la voie ferrée est rehaussée sur un talus de près de deux mètres. Les maisons les plus proches étaient, au moins, à 300 m.
Après préparation minutieuse, où rien ne fut oublié, pas même le repli dans la cabane de jardin après opération, pour y passer le reste de la nuit, et voilà l’équipe formée. J’en étais le responsable, et j’avais avec moi des hommes sûrs, courageux, solides, sur lesquels on pouvait compter : Alfred Ottino, de Saint-Ouen (un ancien des Brigades internationales d’Espagne) ;

Lumeau, ancien secrétaire syndical des Métaux de Saint-Ouen ; Ermelinger, ancien secrétaire syndical des Métaux du 18e arrondissement ; et Jean Capré de Saint-Denis. » Chauffeur au dépôt de La Plaine, militant cégétiste, recherché par la police, Capré est déjà passé dans la clandestinité sous le nom de Lucien Dumont. « On était convenu que Lumeau ferait le guet au virage de la voie, muni d’un mauvais revolver en guise de protection et d’une lampe électrique pour donner l’alerte par trois allumages successifs en cas de nécessité et pour « décrocher » en vitesse.
Nous restions donc à quatre, et ce n’est pas de trop pour débloquer les tire-fond, un de chaque côté à chaque traverse, en bois dur comme on ne peut se l’imaginer. Après, il y a les boulons et les écrous des éclisses. Là, il faut des bras musclés pour déboulonner les plaques épaisses qui tiennent de chaque côté le rail bien en ligne en bout à bout. Difficile de dévisser : souvent c’est rouillé, comme si c’était soudé ! On en a attrapé une suée et des ampoules aux mains. Nous n’avions pas le temps de souffler et il fallait éviter de faire du bruit. Facile à dire : du fer et de l’acier qui s’entrechoquent, cela résonne et s’entend encore plus dans le silence de la nuit ! Ouf ! Tout est prêt, avant l’arrivée de la machine haut le pied, dévissé, déboulonné. Mais bien sûr on avait laissé les rails en place. On s’était « planqué » à plat ventre, en bas du talus. Il n’y aurait plus qu’à remonter pour riper chaque rail, avec des barres à mine – tout en respectant les minutes imparties qui défilent dans ces cas-là à toute allure. Cette « technique » du déraillement (faute de disposer de charges de plastic, plus rapides à poser et qui font tout exposer) nous avait été expliquée dans le détail bien avant, car d’autres groupes de l’OS, opérant quelque part en France, avaient fait l’expérience de déraillements « loupés ». Par exemple, si on n’écartait qu’un seul rail… le train passait.
À peine la locomotive haut le pied venait-elle de passer que toute notre équipe sortait du bas du talus et bondissait sur la voie, cette fois avec l’unique mission de riper le plus possible les deux rails parallèles, et de déguerpir au plus vite en emportant chacun notre lourd matériel. » À peine abrités, « le convoi arrivait dans un bruit terrible, pire que le tonnerre, un vacarme de tonnes de ferrailles heurtant d’autres tonnes de ferrailles. Puis, une gerbe de feu illuminait le ballast, et tous les environs. C’était la locomotive à vapeur qui, sans aucun doute, avait basculé dans le ravin, et des wagons aussi, avec leur chargement, le tout encastré l’un dans l’autre.
On n’a pas pris le temps de contempler le spectacle. Nous sommes partis, à grandes enjambées, sans panique sur les petits chemins des jardins, évitant la route en direction de Saint-Denis, en nous éloignant le plus possible de la voie de chemin de fer. Quand, soudain, on entendit des bruits de motos et de voitures allemandes se rapprochant. On était sans doute trop près de la route, il fallait s’en éloigner à tout prix ! » Avec satisfaction, les saboteurs peuvent lire dans Le Matin du lendemain un compte rendu : « 60 wagons déraillent près d’Épinay. Une dizaine de wagons sortent des rails et les deux locomotives sont couchées sur la voie, labourant le ballast sur une longueur d’une cinquantaine de mètres. Plusieurs wagons sont tombés de deux à trois mètres de hauteur. L’attentat est flagrant. Les saboteurs sont des hommes de métier. […] Les dégâts matériels sont considérables. » En représailles, la population d’Épinay est obligée de surveiller la voie, de jour et de nuit, à tour de rôle. Quelques jours après, une affiche à croix gammée et une autre de la préfecture de police, sont placardées sur les murs de Paris, annonçant qu’un million serait versé à qui permettrait de retrouver les « terroristes ». Encouragé par ce premier succès, Capré va tenter un nouveau grand coup que relate Linet 7 : « Le 20 juillet 1941, le trafic ferroviaire fut à nouveau visé dans notre région. Capré, un cheminot avec lequel j’étais en liaison, avait déjà participé à deux ou trois actions de sabotage de locomotives au dépôt de la Chapelle. La potée d’émeri dans les pistons, c’est radical pour que ça coince : une fuite de tuyauterie et c’est la panne. Mais c’est risqué de récidiver, alors nous étions convenus de tenter quelque chose de plus important.

Au moment prévu, Capré a fait, volontairement, sa fausse manœuvre et sauté, et vite fait avant que la loco ne heurte le bastingage au lieu de se trouver dans l’axe des rails. Et voilà ce poids énorme qui bascule dans la fosse avec son tender.
Le dépôt, ainsi que plusieurs locos furent immobilisés pendant plusieurs jours et la réparation nécessita beaucoup plus de temps. Évidemment, Capré n’a plus « pointé » les jours suivant ; il pouvait continuer ailleurs à frapper l’ennemi. » (Voir encadré ci-dessous.)
Tous ces événements survenus dans la « banlieue rouge » au nord de Paris 10 inquiètent à juste titre le préfet de police de la Seine, l’amiral Bard. Celui-ci, le 30 juillet, s’adresse ainsi au secrétaire d’État aux Communications : « J’ai l’honneur de vous transmettre copie des résultats de l’enquête judiciaire qui a été faite à la suite de l’attentat du Dépôt des machines du Landy [dépôt annexe de la Chapelle, confondu avec celui de la Plaine].
À cette occasion, je crois devoir vous signaler qu’une activité intense du parti communiste clandestin semble se manifester dans ce dépôt, notamment par d’abondantes distributions de tracts. J’attire surtout votre attention sur cet attentat parce qu’il démontre, avec le déraillement d’Épinay, l’efficacité des consignes de sabotage abondamment diffusées par les dirigeants communistes, qui se proposent de faire tout ce qui est en leur devoir pour nuire au ravitaillement de l’Allemagne en guerre avec la Russie soviétique.
Dans ces conditions, il me semble de toute nécessité que des ordres formels soient donnés à la SNCF pour que des mesures énergiques soient prises pour lutter contre la propagande communiste clandestine. Il importe que les cadres supérieurs et subalternes, qui jusqu’à ce jour ne se sont pas efforcés le moins du monde de mettre un frein à cette activité subversive, sortent de leur passivité actuelle et entreprennent une lutte énergique contre les meneurs, agitateurs et distributeurs de tracts.
Il importe enfin que la SNCF donne à ses agents l’autorisation de signaler immédiatement à la police tous faits susceptibles de l’intéresser, sans attendre un ordre supérieur souvent long à venir.
Les efforts des agitateurs communistes ne se limitent pas à la SNCF, ils s’étendent également au personnel des autres services publics et notamment des PTT ; les propagandistes exploitant le mécontentement du personnel subalterne, dont la situation matérielle est difficile, s’efforcent maintenant d’inciter les éléments des « Groupes clandestins de base » à commettre des actes de sabotage et à détruire les lignes télégraphiques et téléphoniques. Il importe donc que là aussi des ordres formels soient donnés pour mettre un terme à ces agissements qui mettent gravement en péril l’ordre public. » Alors que la presse communiste clandestine met en avant les hommes du rail, que ce soit dans La Vie ouvrière du 9 août (« Honneur aux cheminots qui luttent contre les fascistes oppresseurs ») ou dans L’Humanité du 12 août (« Cheminots, refusez de conduire les trains de matériel de guerre allemand »), la préfecture de police fait distribuer le 18 août pour affichage dans les gares de la Seine et de Seine-et-Oise un « Avis à la population ». Celle-ci est invitée à s’associer « à la répression et même à la prévention de ces attentats », une récompense d’un million de francs étant offerte à toute personne qui permettra d’arrêter les auteurs des attentats commis contre les voies et le matériel de chemin de fer.
Les instructions policières retransmises au sein de la SNCF ne vont pas rester sans effets : selon leurs penchants idéologiques, les cadres les exécuteront avec zèle ou, au contraire, les saboteront. Au début de l’automne, ainsi, le directeur de l’Exploitation de la région Nord justifie auprès de Darlan sa conduite nuancée et l’intérêt de lever les sanctions visant de simples suspects :
« Amiral, j’ai l’honneur de vous confirmer la demande que vous avez bien voulu me permettre de présenter dans notre entretien du 25 courant.
Un acte de sabotage particulièrement grave a été commis au dépôt de la Plaine le 20 juillet 1941. À la suite de l’enquête menée par vos Services, 13 agents de cet Établissement ont été arrêtés et sont actuellement internés à Châteaubriand (Loire-Inférieure).
J’ai intensifié, depuis cette époque, la propagande et la lutte contre les menées antinationales en y associant le personnel de maîtrise à tous les degrés de la hiérarchie. Dans la seule région parisienne (secteur de la Région Nord SNCF), le nombre des agents licenciés est passé depuis cette date, de 24 à 57. Parmi les nouveaux licenciés figurent trois agents du dépôt de la Plaine, dont deux actuellement internés à Châteaubriand.
J’ai fait examiner de près le cas des 11 autres agents internés. Je crois pouvoir affirmer qu’il ne se trouve parmi eux aucun partisan, ni aucun propagandiste des actes de sabotage et qu’ils peuvent reprendre leur emploi au chemin de fer sans inconvénient pour le service que j’ai la responsabilité d’assurer. Leur libération produirait un effet salutaire à La Plaine et servirait même la propagande à laquelle j’ai fait allusion plus haut ; par mesure de prudence, elle pourrait d’ailleurs n’être que progressive.
Tels sont les motifs pour lesquels j’ai l’honneur, Amiral, de vous demander la libération des agents figurant sur la liste ci-annexée classée en deux groupes par ordre d’urgence. Veuillez agréer, Amiral, l’assurance de sentiments d’autres considérations.

Liste des agents du dépôt de La Plaine actuellement internés à Châteaubriand :
A) dont la SNCF demande la libération :
1°) immédiatement : Blondeau, Antoine, mécanicien de manœuvre ; Capron, Amédée, ouvrier ajusteur ; Gallet, Georges, surveillant de dépôt ; Pajon, Césaire, ouvrier ; Rehault, Alphonse, élève mécanicien.
2°) en deuxième étape : Alexandre, Marcel, ouvrier ajusteur ; Berti, Vincent, ouvrier chaudronnier ; Brémont, André, ouvrier ajusteur ; Théry, Pierre, sous-chef de brigade ajusteurs.
3°) ultérieurement : Decez, Marie, ouvrier monteur ; Wintrebert, Robert, ouvrier chaudronnier.
B) licenciés par arrêté de M. le secrétaire d’État aux Communications : Aurières, René, manœuvre spécialisé ; Dewaele, Pierre, ouvrier ajusteur. » Attitude répressive donc modulée, dosée en vertu du calcul de ses retentissements psychologiques. Inversement aux agents qui seront déportés en Allemagne, voire fusillés, ceux qui seront libérés pourront témoigner favorablement à la Libération de la mansuétude de leurs dirigeants en portant un jugement contradictoire sur les mêmes personnes…
Georges Ribeill