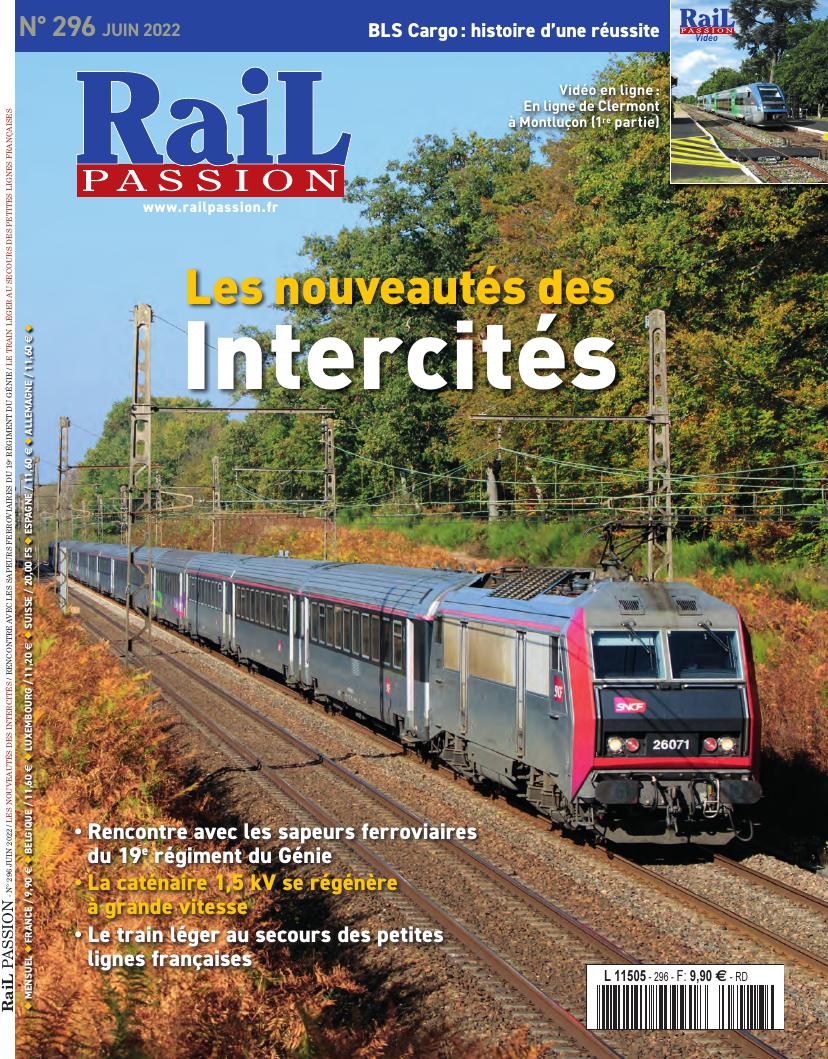Dans cette seconde partie de notre dossier, nous allons voir comment Paris-Montparnasse, qui a accueilli ses premiers TGV Atlantique en 1989, poursuit aujourd’hui encore sa modernisation.
Nouvelle extension de la gare et couverture des voies avant le TGV Atlantique
Compte tenu de la saturation progressive des axes ouest Paris – Versailles – Rambouillet – Chartres et sud-ouest Paris – Étampes – Les Aubrais, la décision est prise de créer au début des années 80 la LGV Atlantique. Seconde du nombre sur la SNCF avec un tracé en Y jusqu’à Courtalain, rejoignant Le Mans et Tours, elle a la chance de pouvoir réutiliser en banlieue ouest de Paris la plateforme du parcours inachevé Montrouge – Massy-Palaiseau, de la future ligne avortée de Paris à Chartres par Gallardon. La gare parisienne de Montparnasse qui accuse alors un trafic annuel total de 38 millions de voyageurs est désignée pour assurer l’ensemble du trafic des TGV innervant la Bretagne, les Pays de la Loire et ceux vers l’Aquitaine, Toulouse, Hendaye et Tarbes détournés de Paris-Austerlitz. Elle va devoir être adaptée à ce futur trafic non seulement pour ce qui concerne le plan des voies à quai, mais aussi ses itinéraires d’accès dans l’avant-gare et la reconfiguration du plateau de Montrouge-Châtillon appelé à assurer le garage et la maintenance des rames. Près de cinq ans de travaux intensifs particulièrement gênants pour l’Exploitation et la clientèle vont être nécessaires pour remanier la gare Montparnasse style 1965, avec 24 voies à quai recouverts sur 22 d’entre elles, un parking de 700 places. La gare sera chapeautée par une dalle-jardin de 55 000 m2 baptisée Atlantique faisant office de poumon vert, avec des aires de jeux, courts de tennis au centre des immeubles en U. La façade de la gare désignée Porte Océane sera ornée d’un vaste arc de cercle en verre et métal, encadré de deux piles de granit rose breton, affirmant l’identité de la gare, oeuvre de l’architecte de la SNCF Jean-Marie Duthilleul. Les dispositions intérieures des locaux et espaces du bâtiment seront rafraîchies et améliorées pour favoriser les flux et l’accueil de la clientèle. Une gare bis dite Pasteur (Montparnasse 2) accolée au pont des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon supportant lui-même des immeubles de bureaux de formes circulaires (concaves et convexes), accessible directement en voiture et taxi, sera composée par un accès transversal supplémentaire avec tous les services, long de 150 m, large de 30, à mi-quai de l’ensemble des voies avec ascenseurs et escalators. Le pinceau des six voies centrales réservées à la banlieue où les impasses V, W disparaîtront, dont les quais seront ramenés à 225 m verra ses heurtoirs reculés vers l’ouest pour l’aménagement en fond de voies du contrôle automatique banlieue. Un accès direct depuis les salles du métro sera aménagé sans interférer par la plateforme frontale réservée aux voyageurs grandes lignes et grande couronne. Durant les travaux, la desserte a dû être simplifiée avec suppression des missions terminus Sèvres-RG. Les deux groupes de voies encadrantes (1-11 et 17-24) auront eux leurs quais allongés à 480 m pour y inscrire deux rames TGV A avec entrée-sortie à 60 km/h. Ceci oblige à un décalage intégral de tous les appareils de voie et de la signalisation. Jusqu’à la bifurcation de Vanves où se séparent les voies vers Montrouge-Châtillon, le nombre de voies principales devant passer de six à huit justifiera un élargissement de cinq ponts-rails, la reconstruction d’un saut-de-mouton. Pour pouvoir effectuer les travaux de voies et de leurs équipements selon des phases successives (décalage des quais, suppression des abris parapluies, caténaires, signalisation), une gare de dégagement (aujourd’hui dénommée Montparnasse 3) a dû être édifiée par avance sur le site marchandises de Vaugirard en vue de soulager la gare principale pendant les innombrables chantiers. Outre un gril de stationnement en arête-de-poisson pour le remisage de machines électriques et diesels, elle comprend quatre voies à quai de 395 m numérotées 25-28 partiellement recouvertes côté heurtoirs par une dalle-parking pour 160 voitures (notamment celles des TAA) et le bâtiment multiservice Cotentin devant abriter à la fois le futur PRCI couplé avec un PMV contrôlant le plateau de Vouillé, le PAR de la ligne à grande vitesse (LN 2), le bureau Mouvement du dépôt de Montrouge et un foyer pour les agents de conduite de 119 chambres.