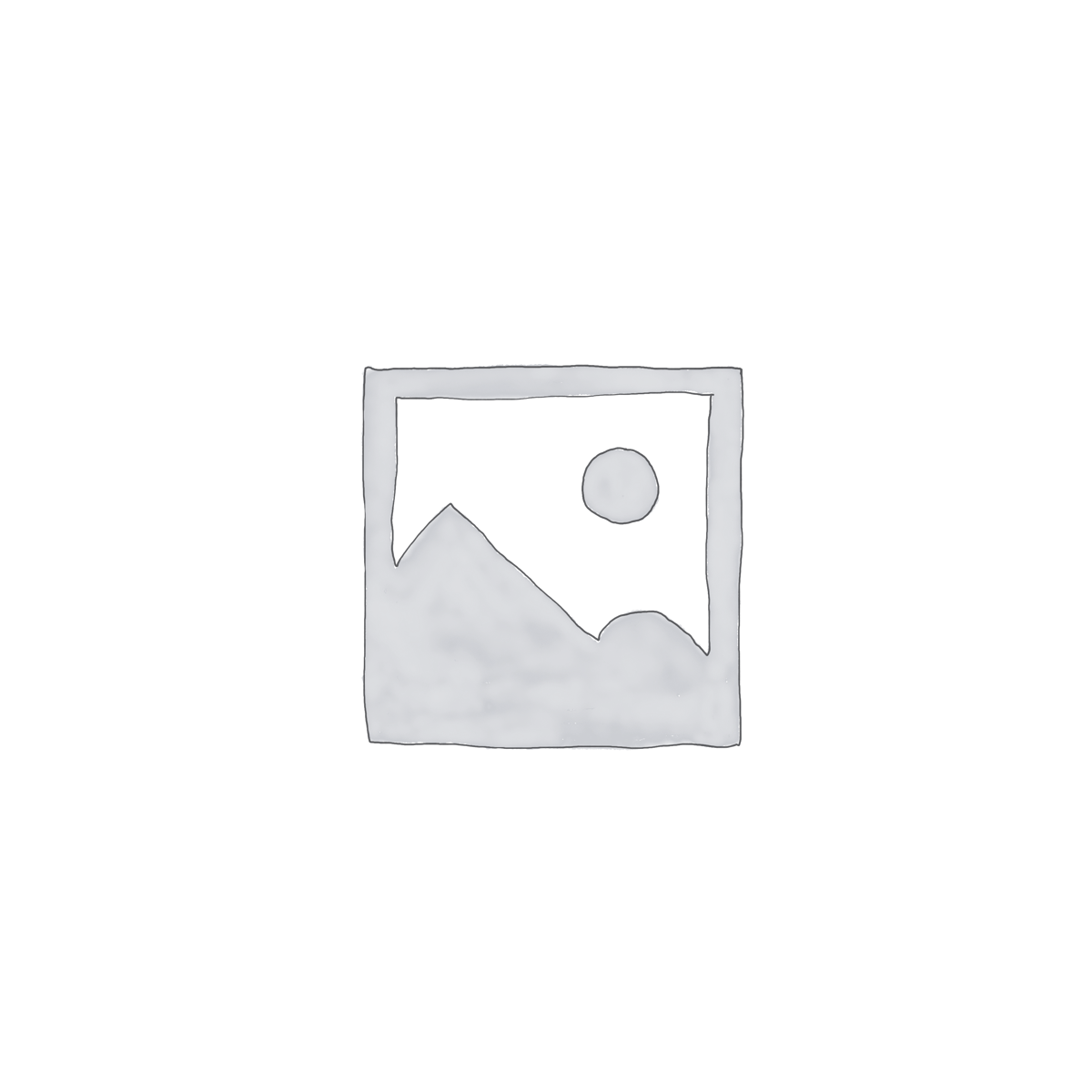La version canadienne du programme de relance économique profite au transport ferroviaire de voyageurs. Un précédent plan d’investissements de 516 millions de dollars canadiens (un dollar canadien vaut 0,65 euro), décidé fin 2007, vient d’être complété par une enveloppe de 407 millions de dollars, dans la foulée de la crise financière. Ce total de 923 millions va permettre, sans attendre un hypothétique train à grande vitesse, d’améliorer les infrastructures et le matériel utilisés par Via Rail Canada, l’agence fédérale du transport ferroviaire de voyageurs, pour déboucher sur une amélioration des vitesses et des fréquences sur les lignes les plus chargées, le triangle Montréal – Ottawa – Toronto.
En matière d’infrastructures, la ligne Montréal – Toronto va connaître une métamorphose. Propriété de Canadien National, cette artère, la « subdivision Kingston », est à double voie sur la totalité des 540 km du parcours.
Sur les fonds débloqués en 2007, une phase 1, en cours de réalisation, vise à la création d’une troisième voie latérale sur un total de 64 km en trois sections de 32, 20 et 12 km. Sur ces segments, les trois voies seront banalisées, comme le sont systématiquement les voies multiples sur le réseau. À Belleville, près de Toronto, une quatrième voie sera construite pour accroître la capacité de la gare. Mise en service prévue en 2011. Fait nouveau dans les mœurs ferroviaires canadiennes, la marche à droite sera posée comme prioritaire aux régulateurs, entraînant l’abandon du principe de mise à quai côté bâtiment voyageurs. Cette dernière pratique, qui occasionne des acrobaties de gestion des voies banalisées aux approches des gares en ligne, découle d’un règlement fédéral imposant le consignement de tout canton de voie principale traversée par des voyageurs à pied en gare.
Logiquement, les gares de cette subdivision Kingston sont donc appelées à être dotées de passages supérieurs piétons : Belleville en banlieue de Toronto (dotée d’une quatrième voie) et les gares de pleine ligne d’Oshawa, Cobourg et Brockville, dotées de nouveaux quais, ainsi que Dorval sur l’île de Montréal, à proximité de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau. L’hypothèse de passages inférieurs a été abandonnée en raison de la nature des terrains, des interférences des travaux sur le trafic et de considérations budgétaires.
Une phase 2 du projet, assise sur les fonds débloqués dans le cadre du plan de relance, consistera en l’équipement d’autres tronçons de la « subdivision Kingston » d’une troisième voie banalisée, permettant de porter le cumul des sections triplées de 64 km à 130, voire 160 km.
Cet effort particulier sur l’infrastructure CN n’est-il pas contradictoire avec le projet, encore récemment réaffirmé, d’une ligne à grande vitesse Québec – Windsor ? « Non », répond l’ingénieur ferroviaire André Gravelle, au siège national de Via Rail, à Montréal. Il explique : « Notre part de marché doit augmenter sans attendre. Il est difficile de faire un acte de foi en lançant un projet de train à grande vitesse à partir d’un marché insuffisamment achalandé. La meilleure façon de faire avancer le rail c’est, dès à présent, d’améliorer sensiblement l’offre de service. »
Malcolm Andrews, directeur général de la communication de Via Rail, précise de son côté : « Pour que le rail gagne en crédibilité, il nous faut encore améliorer notre couverture des coûts par les recettes, qui est de 60 % à présent après avoir été de 30 % il y a trente ans. »
De fait, ces améliorations d’infrastructures permettront d’améliorer la vitesse commerciale sans avoir à relever les vitesses limites, déjà de l’ordre de 160 km/h grâce à un excellent armement des voies en LRS d’un poids dépassant les 60 kg/m. L’objectif, en 2011, est de réduire le temps de parcours, actuellement de 4 heures 59 minutes pour 539 km, soit une vitesse commerciale de 108 km/h – une belle performance en traction thermique –, « d’une trentaine de minutes grâce à une plus grande fluidité du trafic et à la création de services express », précise Malcolm Andrews. Soit 4 heures 20 minutes, correspondant à une vitesse commerciale relevée à 124 km/h.
La ligne reliant Montréal à Ottawa, capitale fédérale, qui se débranche de l’axe Montréal – Toronto à Coteau, à 63 km à l’ouest de Montréal, vient de subir une sérieuse cure de rajeunissement pour 12,5 millions de dollars. Cette « subdivision Alexandria » Coteau – Ottawa, pour l’essentiel, a été acquise à CN en 1998 par Via Rail. Cette dernière y alloue d’ailleurs un sillon quotidien à un tractionnaire fret short liner, un cas atypique en Amérique du Nord… Elle est progressivement équipée de longs rails soudés, depuis 2002. Cette année, elle a été dotée d’un nouvel évitement situé à 16 km à l’est d’Ottawa, à Carlsbad Spring, d’une longueur (modeste pour le Canada) de 760 m. Via Rail vient par ailleurs d’acquérir la pleine propriété de 10 km résiduels d’infrastructure auprès de Canadien National (vers Montréal) et d’une portion de ligne de Canadien Pacific (vers Toronto), à proximité d’Ottawa.
La signalisation vient d’être modernisée et centralisée. La gare d’Ottawa, construite en 1966 en périphérie de la capitale fédérale, après la suppression malheureuse de l’ancienne gare souterraine de plein centre, a été rénovée.
Sur Ottawa – Kingston (Toronto), d’importants renouvellements de voies sont programmés à court terme entre Ottawa et Smith Falls, sur une soixantaine de kilomètres.
Sur la ligne Montréal – Québec, enfin, parcourue par les trains Via Rail reliant les deux villes et par les trains de nuit de et vers Halifax et Gaspé, rien n’est programmé en termes d’infrastructures dans le cadre des deux plans d’investissement Via Rail en cours. CN, voici une dizaine d’années, avait allongé ses voies d’évitement sur la section à voie unique, à l’est de Saint-Hyacinthe, à 54 km de Montréal. Cet autre segment du Transcanadien est au demeurant équipé d’une voie d’excellente qualité.
En termes de fréquence, l’ensemble de ces améliorations d’infrastructures va permettre de densifier l’offre. En jour ouvrable de base, Via Rail prévoit d’ajouter deux rotations aux 6 allers-retours actuels Montréal – Toronto et deux rotations aux 5 allers-retours Ottawa – Toronto actuellement parcourus en 4 heures 37.?La liaison Montréal – Ottawa bénéficie déjà de 6 allers-retours.
Côté matériel roulant, le plan de modernisation complété par le plan de relance prévoit une rénovation massive des engins de traction comme du matériel tracté.
Concernant le parc des voitures voyageurs, les célèbres LRC (Light Rail Cars) vont être modernisées au titre du plan de relance. Conçues en 1968 par le consortium Dofasco, Alcan et Montréal Locomotive Work (devenu Bombardier), acquises en 1978 et 1981 par Via Rail pour 98 unités, elles sont autorisées à la vitesse de 152 km/h. C’est la société Irsi, sise à Moncton au Nouveau-Brunswick, qui va totalement réviser ce matériel constitué de monocoques d’aluminium, pour 98,9 millions de dollars. Au programme : rénovation des bogies, attelages et intercirculations, traitement anticorrosion des caisses, amélioration de l’efficacité énergétique tant par un nouveau câblage que par de nouveaux moteurs de portes et un conditionnement « intelligent ».
Objectif : prolonger d’une vingtaine d’années la durée de vie de ce matériel profondément novateur en Amérique du Nord.
Cette rénovation massive viendra épauler les 106 voitures Alstom construites pour les trains de nuit mort-nés du Transmanche. Via Rail avait racheté le lot de 139 en 2000, sans possibilité de n’en acquérir qu’une partie, comme il l’aurait souhaité. L’exploitant a néanmoins pu ainsi cannibaliser plusieurs éléments pour optimiser le parc en service. Notons que ce matériel ne correspond pas aux normes américaines de résistance au tamponnement, qui imposent une capacité de résistance de 800 000 livres (174 tonnes métriques) contre la moitié en Europe. Pour cette raison, une voiture de transition sans voyageurs est imposée entre la rame ouverte au service commercial et la locomotive.
Six automotrices aluminium Budd sont par ailleurs réhabilitées, utilisées sur liaisons isolées de l’île de Vancouver (Colombie Britannique) et Sudbury-Whiteriver (Ontario). Une option de rachat d’une quinzaine d’autres est à l’étude. Le reste du parc est complété par des voitures Budd des années cinquante ex-CP, dénommées Streamliner.
Concernant le matériel de traction, les 54 locomotives F40 de General Motors vont être rénovées au titre du premier plan d’investissement, complété à la marge par le plan de relance. Elles avaient été acquises en 1987 après l’échec des motrices profilées conçues spécialement pour les rames LRC dont elles respectaient la ligne de toiture. Leurs moteurs, non suspendus, s’étaient révélés trop agressifs pour la voie.
Très présentes en Amérique du Nord (Amtrak les a étrennées à la fin des années soixante-dix et elles sillonnent de nombreuses banlieues), les F40 de Via Rail vont être réhabilitées pour une prolongation de carrière de 15 à 20 années par les ateliers CAD de Lachine, en banlieue de Montréal. L’exploitant en attend une baisse d’émission de gaz à effet de serre de l’ordre de 12 %, après une diminution de 16 % déjà réalisée. Les économies cumulées de ces locomotives aptes à 153 km/h devraient se chiffrer à 5 millions de litres de gazole par an. Un moteur diesel leur sera ajouté pour générer l’électricité des rames tractées.
C’est donc bien un plan ambitieux pour le rail qui se réalise sur le dense et prometteur corridor Québec – Windsor, lequel réunit l’essentiel de la population des deux provinces les plus peuplées du Canada. Québec et Ontario cumulent près de 21 millions d’habitants, près des deux tiers des 34 millions de Canadiens.
Les récentes élections municipales au Québec auront scellé le grand retour du train à grande vitesse dans l’arène politique. Le maire de Québec, Régis Labeaume, a plaidé très vivement cet automne pour que la première phase du projet parte de Québec. Une exigence relayée par le Premier ministre provincial Jean Charest (libéral), le 30 septembre : « Nous voulons, nous insistons pour que le trajet se fasse de Québec à Montréal, ensuite de Montréal à Toronto. Parce que, si on ne le fait pas au départ avec Québec, les chances que ça se fasse un jour sont à peu près nulles. » Un thème auquel s’est ralliée l’opposition libérale au niveau fédéral, dont le responsable transport, Joe Volfe, qui a confié au journal Le Soleil, de Québec, sa volonté que cela soit fait « en une seule phase ». Enjeu municipal, provincial et fédéral relancé par les questions climatiques et les plans de relance du grand voisin états-unien, le futur réseau canadien de LGV aura connu une interminable gestation.
« Un comité des transports a été réuni récemment à Ottawa et a réexaminé le dossier », confie André Gravelle, ingénieur chez Via Rail. Représentants fédéraux de l’Ontario et du Québec y ont réexaminé le sujet. Avant qu’ils ne publient leurs conclusions, deux audits ont été demandés. Les grandes villes concernées ont demandé une étude prospective à la SNCF pour un coût de 375 000 dollars. Ses conclusions, publiées en juin, ont montré l’opportunité commerciale du réseau sur le corridor, étendu à Chicago et New York. Les gouvernements provinciaux et fédéral ont pour leur part demandé une étude à la firme Dessau et au cabinet Éco-Train, pour un coût de 3 millions de dollars, dont le résultat est attendu début 2010. Elle devra synthétiser et actualiser les travaux réalisés auparavant.
Il faut dire que les avant-projets n’auront pas manqué. Dès 1981, Via Rail Canada réalise des études complètes en collaboration avec la SNCF et les chemins de fer japonais. Elles débouchent en 1984 sur un rapport préconisant un réseau à grande vitesse voyageurs s’étirant de Québec à Windsor (1 150 km) et desservant Montréal, Ottawa, Toronto, ainsi qu’une liaison Calgary – Edmonton, à l’ouest du Canada.
Via Rail reprend son avant-projet en 1987, travail débouchant sur un nouveau rapport en 1989, suscitant un intérêt plus marqué que le précédent de la part des trois gouvernements les plus concernés (fédéral, Ontario, Québec). De ce fait, un groupe de travail est constitué en 1990. Cette commission Bujold-Carman remet en 1992 un rapport sur la rentabilité socio-économique, le financement, l’environnement et les questions industrielles. L’année suivante, les études initiées par les trois gouvernements sont actualisées sous l’égide de leurs ministres des Transports respectifs.
Si Via Rail ne mène plus d’études en propre à l’heure actuelle, elle pose comme quasi-certitude qu’une infrastructure nouvelle relierait Québec à Montréal par la rive nord du Saint-Laurent et non par la rive sud comme la ligne classique CN, empruntée actuellement par ses trains, afin d’éviter deux franchissements du fleuve. Ce qui ravit Yves Lévesque, le maire de Trois-Rivières, ville située à quelque 150 km de Montréal et Québec sur la rive nord : « Cela ne prendra que 30 minutes pour se rendre au centre-ville de Montréal », prévoit-il déjà, déplorant « qu’on nous [ait] enlevé le train il y a plusieurs années », en 1990. Miracle du train à grande vitesse outre-Atlantique : on se bat de nouveau pour avoir des trains !
Alors que se prépare l’aménagement d’une sixième ligne de banlieue dans l’agglomération de Montréal sous l’autorité de l’Agence métropolitaine des transports (AMT), le « train de l’Est » vers Repentigny et Mascouche, l’année 2009 aura été celle des grands avant-projets pour le métro de la capitale économique du Québec. Le premier ministre provincial Jean Charest a annoncé le 16 septembre la création d’un bureau de projet doté d’un budget de 12 millions de dollars pour trois ans afin de réaliser les études nécessaires à la construction de douze nouvelles stations sur trois prolongements de lignes totalisant 20 km.
Objectif : une mise en service dans 10 à 15 ans. Coût estimé : 3 milliards de dollars. La ligne Orange (n° 2), déjà prolongée de trois stations (5,3 km) l’an dernier au nord-est d’Henri-Bourrassa à Montmorency (Laval), via une traversée sous-fluviale de la rivière des Prairies, serait « bouclée » par une mise en liaison de ses deux extrémités nord. Cette nouvelle section relierait sur plus de 5 km Côte-Vertu, actuel terminus nord-ouest, à Montmorency, via deux stations intermédiaires nouvelles (Poirier et Bois-Franc) et une autre traversée sous-fluviale.
La ligne Bleue (n° 5, tangentielle nord) serait prolongée de plus de 5 km et cinq stations supplémentaires de Saint-Michel à Anjou.
La ligne Jaune (n° 4, trois stations), seule à franchir le Saint-Laurent et à rejoindre la rive sud en plein développement, serait prolongée à la demande de la municipalité de Longueil de 8 km et quatre stations jusqu’à Roland-Thérien, aux abords de l’aérodrome de Saint-Hubert, en longeant le Saint-Laurent côté sud.
Les médias montréalais se sont toutefois montrés prudents sur la probabilité de réalisation d’un tel plan, annoncé peu de temps avant la « Journée sans ma voiture » et en pleine campagne électorale pour les municipales. Il y a d’abord la question financière. Le maire de Montréal déplorait au printemps dernier que le déficit structurel des réseaux métro-bus de la STM (Société des transports de Montréal) s’apprête à atteindre 38 millions de dollars en 2009, exigeant une rallonge des subventions provinciales d’un montant de 30 à 55 millions de dollars. De plus, le projet de liaison rail aéroport, promis depuis des années et annoncé comme prochain, tarde à se concrétiser. Bien que deux voies ferrées majeures passent à moins de 1 km kilomètre des terminaux aériens, l’AMT se limite pour l’instant à annoncer que sur onze hypothèses d’avant-projet, seules trois restent en lice. La pose de nouvelles voies le long des corridors ferroviaires CN et CP, en parallèle sur cette section, et le choix d’un terminus à Lucien-L’Allier tiennent la corde. Mais pour l’instant, l’aéroport Pierre-Trudeau, seule plate-forme importante de la ville depuis la fermeture de l’éphémère Mirabel, reste l’un des plus inaccessibles du continent nord-américain, malgré sa proximité du centre-ville. Ses seules voies d’accès, des autoroutes, sont presque toujours congestionnées.
Michel-Gabriel LÉON