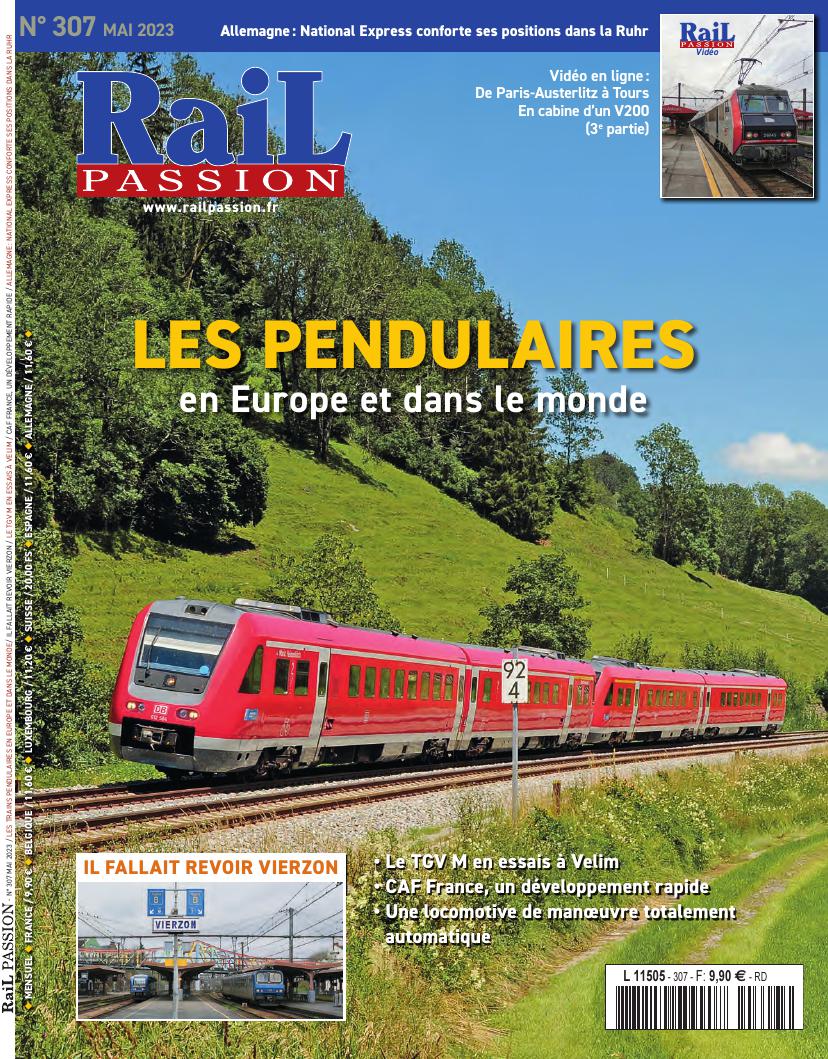La rénovation complète du chemin de fer de la Rhune et d’autres chantiers récents en France montrent que les traverses métalliques demeurent toujours pertinentes, au moins pour certaines applications.
La fonte et les métaux ont très tôt été utilisés pour les appuis et les traverses longitudinales ou transversales (1800 en Écosse, 1836 en Allemagne). C’est en 1858 qu’apparaît la traverse métallique en auge Le Crenier, une configuration qui sera appelée à évoluer, avec par exemple la traverse en trapèze Vautherin de 1868, et qui n’aura de cesse d’être améliorée, notamment pour tout ce qui participe à son ancrage. Certains développements politiques et faits économiques contribueront au déploiement de ce type de travelage. Après la Seconde Guerre mondiale, la part du linéaire en voie de 1 435 mm équipé en traverses métalliques baisse fortement en Allemagne (sans même évoquer la France) et en Suisse (1) au profit du travelage béton. Il n’en demeure pas moins que la traverse métallique convient fort bien aux lignes avec des rayons et des épaisseurs de radier faibles, comme en montagne. Sans surprise, l’industrie helvétique, en l’occurrence Tracknet (2), est très impliquée par la fabrication de traverses en auge qui requiert les opérations suivantes :
• coupe des profilés en provenance d’Allemagne aux longueurs désirées ; • mise des profilés dans un « rack », puis cycle automatique consistant à poinçonner des trous, à souder des nervures, à plier les nouvelles traverses pour leur donner l’inclinaison désirée (1 : 20 ou 1 : 40), à leur bêchage pour augmenter leur résistance latérale ;
• mise en paquet pour la livraison ou prémontage d’attaches ST 14, STi 14 développées avec la société suisse Schwihag, avant chargement sur des wagons dédiés.